COMPTE RENDU DE VOL
Avion : N262 n° 55
Date : 30 juin 1980
N° essai : C-6001
N° vol :
BUT DU VOL :
évaluation :
Calculateurs de décision au décollage/à l’atterrissage
Pilote automatique de trajectoire avec son nouveau système de dialogue Automanettes d’incidence
Masse :
C% :
Pétrole :
CONDITIONS TERRAIN :
Clair- Légère turbulence en approche
Temps de vol : 1h00
Équipage :
GALAN
KLOPFSTEIN (E.R.A.)
DEPEZAY (mécanicien)
LUX (SE/EQ)
Destinataires :
SDT/PN M. Klopfstein (E.R.A.)
SDT/SE M. HISLER
SE/EQ (M. Coffin)
CALCULATEUR DE DÉCISION
Présentation : Sur un tube cathodique (CRT) trichrome Thomson situé au centre du tableau de bord apparaissent au décollage :
- L’avion à sa position instantanée actuelle
- La piste vue de profil avec l’obstacle de 35 ft en fin de bande (obstacle réglementaire), avec échelle dilatée en altitude par rapport à la distance.
- La trajectoire suivie par l’avion depuis le lâcher des freins, avec un trait toutes les secondes (donc traits d’autant plus espacés que l’avion va vite)
- Le point d’arrêt prévu en cas d’interruption du décollage (flèche), voir plus loin sa signification exacte.
- La trajectoire prévue en cas de poursuite du décollage avec un moteur en panne.
- Un repère noté STOP (clignotant) ou GO (fixe) donnent une information sur les possibilités du système instantanément (voir plus loin).
- Un ensemble de deux » boîtes » (une pour le maxi continu, l’autre pour la poussée décollage) dans lesquelles vient se placer un triangle représentant l’énergie totale (vario à énergie totale) de l’avion ; instantanément, compte tenu des conditions réelles (poussée réelle des moteurs, configurations, pression résiduelle essentielle des freins, etc.).
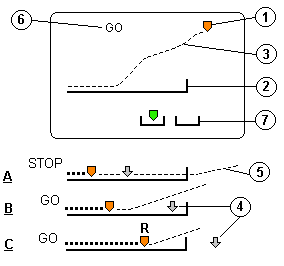
Fonctionnement : A la mise en route, le CRT sollicite du pilote l’affichage de certaines données nécessaires aux calculs. Essentiellement :
- La longueur de piste réelle
- Le SDR (Stopping Distance Ratio), qualifiant l’adhérence des roues sur la piste au freinage et qu’on peut prendre sur piste sèche égal à 1, sur piste mouillée égal à 2. Ce SDR ne peut être MESURE par l’avion en accélération au décollage. Pour le mesurer, il faut un freinage sur la piste à 80 kt environ, ce qui pourrait être fait par un véhicule équipé.
- D’autres paramètres utiles aux calculs ne sont pas actuellement introduits, mais pourraient l’être simplement : la pente de la piste et les obstacles de la trouée d’envol en particulier.
Après le lâcher des freins, à mesure que l’avion accélère (figure A ci-dessus), le point d’arrêt s’éloigne progressivement, et la prévision de trajectoire se rapproche. En A, la décision de s’arrêter est évidemment possible. Par contre, en cas de panne d’un moteur, la poursuite du décollage serait impossible.
Nota :
- Le point d’arrêt est CALCULE (en l’absence de freinage optimisé type SPAD) dans les hypothèses suivantes : butées sol 2 moteurs à l’impact, freinage modéré à partir de 50 kt seulement.
- La trajectoire d’envol est calculée avec : un moteur en panne à partir de l’instant présent (donc avec l’énergie totale pratiquement divisée par deux) – avec les paramètres réels mesurés (température en particulier) – avec le vent (de la tour) introduit, mais qui pourrait à l’avenir être tiré d’une centrale aéro).
- Les » boîtes » à énergie totale du bas permettent de vérifier que le vario à énergie totale correspond bien à la poussée décollage (et permet en particulier de déceler une éventuelle pression freins résiduelle)
- Le voyant » STOP » clignotant indique qu’en cas de panne, il faut IMPÉRATIVEMENT interrompre le décollage.
Pendant l’accélération (figure B ci dessous), il y a une phase où l’on peut envisager soit d’interrompre le décollage, soit de le poursuivre en cas de panne d’un moteur
Le voyant STOP est remplacé par GO qui signifie qu’on PEUT poursuivre le décollage (mais n’indique pas qu’on pourrait encore s’arrêter) en cas de panne
En fin d’accélération (figure C), on voit que le décollage est la seule ressource en cas de panne : l’arrêt est impossible dans les limites de la piste.
Après le décollage (première figure), la pente réelle est bien supérieure à la prévision (un moteur en panne). Si on réduit le moteur momentanément, elle redevient parallèle à la prévision (figure).
A l’atterrissage, la calculateur fonctionne de façon analogue, mais cette fois avec un mesure directe de la décélération. Sur piste courte (figure), on peut voir que l’arrêt va être impossible, et remettre les gaz à temps.
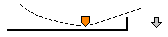
Avis d’ensemble
Ce calculateur est un outil qui est REMARQUABLE, et devrait permettre de repenser totalement les principes de décollage actuellement retenus.
En effet, le principe du calcul de V1 tel que planifié actuellement :
- Repose sur des valeurs de paramètres fournis par la météo et non directement mesurés (bien sûr, le calculateur présenté ne mesure pas actuellement le vent, mais il pourrait facilement utiliser le vent fourni par une centrale, seul le SDR restera à fournir par l’extérieur).
- NE TIENT PAS COMPTE de paramètres tels que :
- Erreurs sur la masse (fréquemment rencontrées en opération dans l’aviation commerciale, en cargo en particulier)
- Freinage résiduel (toujours possible sur des étapes multiples et courtes, avec temps d’escale courts en pays chauds)
- Baisse de poussée d’un moteur
Par Ailleurs, cet appareil laisse à chaque instant le pouvoir de DÉCISION au pilote, ce qui peut aider notablement à la bonne utilisation opérationnelle des avions en exploitation : au départ d’une base principale vers un terrain secondaire, on aura davantage intérêt à interrompre le décollage, et à le poursuivre dans le cas inverse SI L’ON EST CERTAIN des possibilités réelles de l’avion, qu’indique le calculateur de décision.
Critiques : Seules critiques : sur deux points
- LA LOGIQUE de l’information STOP – GO n’est pas bonne. Il faudrait indiquer par la cohabitation des deux qu’il y a possibilité de double décision pendant une certaine phase.
- La PRÉSENTATION sera à améliorer, mais ce n’est que du détail, ne présentant aucune difficulté pratique.
PILOTE AUTOMATIQUE DE TRAJECTOIRE
Fonction » tenue de l’incidence 5,5° «
Cette incidence correspond à peu près à l’incidence de Cx/Cz3/2 mini, c’est-à-dire à la fois :
- A la pente air de montée maximale
- Au plafond de propulsion
- A la marge de manœuvre maximale (ce qui serait intéressant pour un avion de combat seulement)
Le PA est programmé pour maintenir cette incidence quel que soit le vario à énergie totale de l’avion (loi ddT/dt = K1(a-a0) + K2(g / H’/V)).
L’intérêt de cette fonction est ÉVIDENT pour une position des manettes des gaz donnée, l’avion adapte sa trajectoire air à des conditions d’emploi optimales.
En particulier, en cas de panne au décollage, il se place de lui-même en fonction des paramètres RÉELS (masse, poussée, etc.) sur la montée optimale.
Fonction ILS à pente et route commandée
Cette fonction a déjà été présenté (voir C/R de présentation du 19 juillet 1979).
La nouveauté est la possibilité d’introduire les pentes et routes de plusieurs manières. Après embrayage de la fonction tenue de pente – tenue de route, les valeurs actuelles de ces deux paramètres apparaissent au CRT, on peut les modifier :
- Par incréments (de 0,5° en route, 0,33° en pente) par touches / impulsions
- Par rampes, en maintenant la touche correspondante enfoncée, il y a alors un déroulement de la route commandée au CRT, qui va plus vite que le virage (et ne fait pas changer le sens du virage, même au delà de 180°), ou de la pente commandée.
- Par injection d’une valeur qu’on a pré-affichée sur un système de roues codeuses : on peut ainsi pré-afficher la pente (sol) du glide, et l’injecter au PA à la capture du glide.
Ces possibilités de dialogue avec le PA sont maintenant parfaites. Les trois possibilités sont exactement ce qu’on peut souhaiter en vol.
Un approche ILS entièrement faite avec ces trois moyens est facile et précise.
Nota :
- L’idéal sera bien sûr une commande non plus par touches sur le pylône, mais par un » sapin » sur la corne du manche gauche.
- La recopie des valeurs numériques du CRT serait intéressante en analogique sur le viseur.
Avec ces moyens d’entrée, le PA de trajectoire devient un système PARFAIT, permettant par toutes conditions un contrôle idéal de la trajectoire souhaitée, en gardant à chaque instant POUVOIR de DÉCISION
Avec une PERFORMANCE ANALOGUE à celle des systèmes automatiques (DV).
Route moyenne TKE
En finale ILS, un calculateur évalue la ROUTE MOYENNE suivie par l’avion : c’est l’équivalent d’un LOC inertiel. En cas de coupure des ILS à 400 ft, au terme d’une approche ILS entamée à 2500 ou 2000 ft, il est possible de rester TRÈS PROCHE de l’axe en se contentant de suivre au PA cette route moyenne.
AUTOMANETTES D’INCIDENCE
Rien de nouveau depuis la dernière présentation (voir précédent C/R).
Excellent fonctionnement de la tenue d’incidence (4,5°) en approche, avec la même loi que la page précédente, cette fois avec un ddT/dt variable.
Il est important d’avoir sous les yeux un CONTRÔLE de la tenue d’incidence (monitoring). Le viseur (HUD) en présentation d’éléments AIR est bien sûr l’instrument idéal.
Ce qui fait que bien que l’automanette d’incidence représente en soi un outil remarquable, c’est l’ENSEMBLE qu’elle fait avec le PA de trajectoire et le viseur qui constitue une révolution dans le principe de pilotage.
DIALOGUE PILOTE-AVION
Le système clavier / CRT présenté est très satisfaisant, dans la mesure où :
- Tous les éléments que le calculateur demande au pilote apparaissent en clair sur le tube, avec la modélisation préparée : il ne reste plus qu’à préparer la valeur et l’injecter après contrôle.
- Tous les ordres que le pilote veut donner au système sont tapée en clair avant d’être injectés au CRT puis dans le calculateur.
- Le CRT donne enfin par lecture directe certaines valeurs actuelles.
CONCLUSION
Pour les avions de la prochaine génération, on dispose :
- De calculateurs aux possibilités quasi illimitées.
- De moyens de présentation de l’information en tableau de bord (CRT) également quasi illimitées dans leurs capacités de figuration.
- De viseurs au point technologiquement.
- D’asservissements performants.
L’ensemble proposé, qui pour beaucoup constitue UN TOUT présente l’énorme intérêt de ne pas refaire de l’ancien avec des moyens nouveaux, mais d’utiliser ces moyens nouveaux pour faire du MIEUX ADAPTÉ au problème du pilotage :
- Les références inertielles sont enfin utilisées au mieux de leurs possibilités et plus seulement pour faire de la navigation
- La vitesse Vc est abandonnée au profit d’incidences plus figuratives (tant sur le plan de la sécurité en approche que sur celui de la performance)
- Le dialogue pilote / machine devient plus direct, sans intermédiaires qui perturbent le rendement.
- La trajectoire est pilotée directement par un pilote parfaitement intégré dans la boucle de pilotage.
A des retouches de détail aisément réalisables, l’ensemble constitue UN ÉNORME PAS EN AVANT, tant sur le plan de la SÉCURITÉ que celui de L’EFFICACITÉ.
Il est regrettable qu’on ne puisse rendre dès à présent l’ensemble présentable sur un grande échelle (un peu par la présentation, beaucoup par la fiabilité) pour » mettre les gens au courant » et renverser les habitudes.
R. GALAN